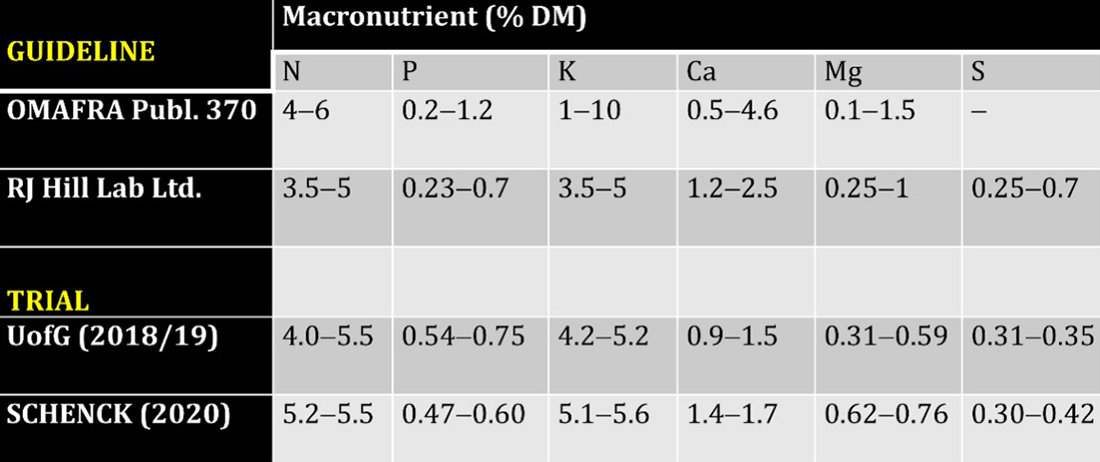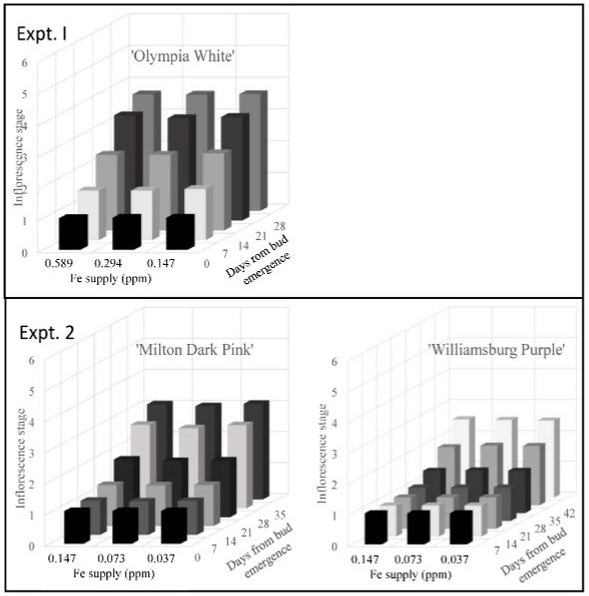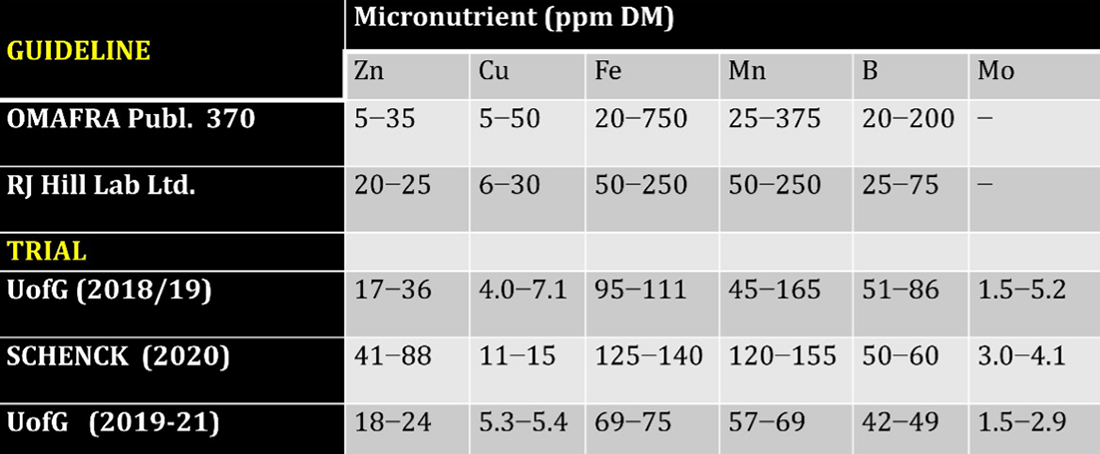L’Alliance canadienne de l’horticulture ornementale est fière de présenter sa première vidéo d’information sur les fonctions et les avantages des systèmes de traitement hybrides, une technique novatrice de traitement de l’eau d’irrigation pour les serriculteurs et les pépiniéristes. S’appuyant sur des résultats de recherches antérieures menées par Ann Huber, Ph. D., ce projet met de l’avant une nouvelle approche pour aider les producteurs à gérer efficacement la qualité des eaux de ruissellement provenant de l’irrigation.
Liens connexes
International Journal of Biometeorology
(2018)
Short communication: thermal regimes in hollow stems of herbaceous plants—concepts and models
Peter G. Kevan1 & Patrícia Nunes-Silva1 & Rangarajan Sudarsan2
Bulletin of the North-Eastern Scientific Center, Russia
(2019)
Temperatures within flowers & stems: Possible roles in plant reproduction in the north
Peter G. Kevan1, Evgeniy A. Tikhmenev2, Patricia Nunes-Silva1
OPEN ACCESS GOVERNMENT, University of Guelph
(2019)
How plants regulate their body temperatures: Implications for climate change science & policy
Peter G. Kevan, University Professor Emeritus at the School of Environmental Sciences, University of Guelph
www.researchoutreach.org
(2019)
Secrets of the Stalk: Regulating plant temperature from the inside out
Dr. Peter Kevan
Annals of Botany
(2019)
The thermal ecology of flowers
Casper J. van der Kooi1,*, , Peter G. Kevan2 and Matthew H. Koski3,
1Groningen Institute for Evolutionary Life Sciences, University of Groningen, Groningen, the Netherlands, 2School of Environmental Sciences, University of Guelph, Guelph, Canada and 3Department of Biology, University of Virginia, Charlottesville, VA, USA
Thermochimica Acta
(2020)
In situ calibration of an uncooled thermal camera for the accurate quantification of flower and stem surface temperatures
Ryan A.E. Byerlay a,*, Charlotte Coates a, Amir A. Aliabadi b, Peter G. Kevan a
a School of Environmental Sciences, University of Guelph, Guelph, Ontario, Canada b School of Engineering, University of Guelph, Guelph, Ontario, Canada
Polar Biology
(2020)
Heat accumulation in hollow Arctic flowers: possible microgreenhouse effects in syncalyces of campions (Silene spp. (Caryophyllaceae)) and zygomorphic sympetalous corollas of louseworts (Pedicularis spp. (Orobanchaceae))
Peter G. Kevan1
Newsletter of the Biological Survey of Canada
(December 2020)
Warm & Comfortable within Hollow Stems, Leaf-mines and Galls: Little known habitats for Entomologists & Botanists to explore
Peter G. Kevan1, Charlotte Coates1, Patricia Nunes Silva2, & Marla Larson1
1School of Environmental Sciences, University of Guelph, Guelph, ON N1G 2W1, 2 Programa de Pós Graduação em Biologia, Escola Politécnica, Universidade do Vale do Rio dos Sinos (UNISINOS), São Leopoldo, Brazil, 93022-750.
YouTube video by Scientia Global
Exploring Micrometeorology in Plants

 English
English